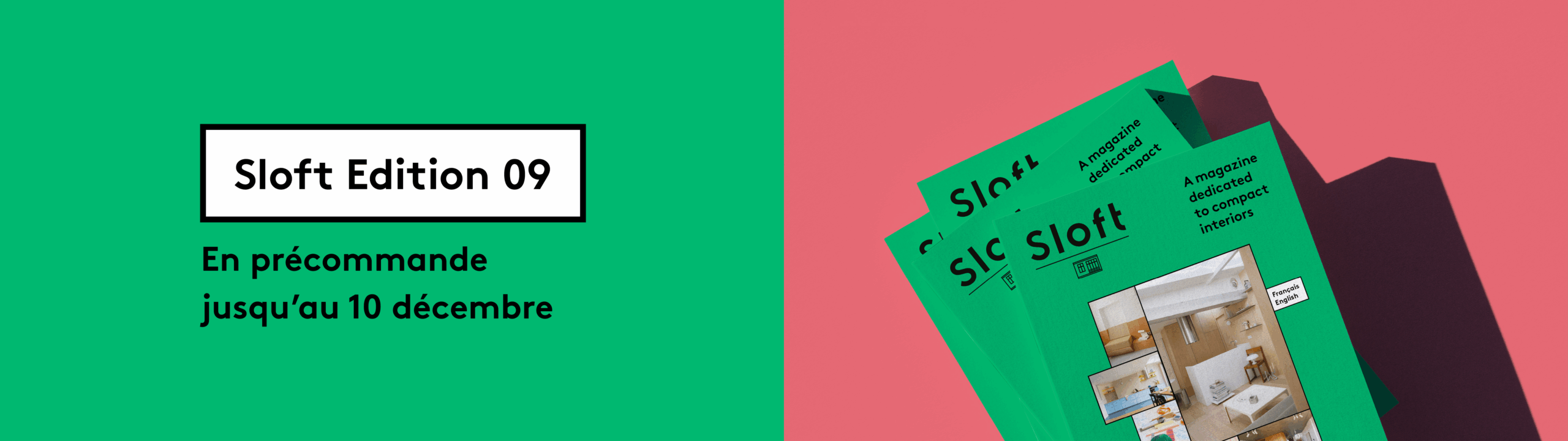Accueil » Reportages » Rencontre avec Benny Nemer, artiste, journaliste intime et chercheur
Rencontre avec Benny Nemer, artiste, journaliste intime et chercheur
Les lumières du Pôle Nord
Par Henri Guette
Dans son domicile parisien de la rue du Pôle-Nord, l’artiste canadien Benny Nemer réinvente la tradition des salons artistiques et intellectuels apparus au XVIIIe siècle. Au travers de ces rendez-vous, il décline dans quelques pièces un art de vivre contemporain.
C’est par l’un des « Salons du Pôle Nord » que j’ai découvert l’appartement de Benny Nemer. Je connaissais un peu le travail de cet artiste canadien, la manière dont il manie l’échange épistolaire, dont son écriture manuscrite se déploie dans l’exposition, mais je ne savais pas où il vivait. Donnant des cours à Gand, il s’est installé dans cet appartement parisien en 2021, comme on se décide à poser ses bagages pour une durée indéterminée. Pour un artiste qui a effectué de nombreuses résidences, pour des durées plus ou moins longues mais toujours prédéfinies, c'était le début d’un nouveau chapitre. Les « Salons du Pôle Nord » permettaient alors de rassembler les ami.e.s et, les uns venant avec les autres, d’en rencontrer d’autres encore mais plus encore… J’ai reçu son invitation sans savoir que chacune de ses occurrences était soigneusement organisée et pour ainsi dire l’objet d’une performance, d’un geste artistique. Le jour de la Saint-Sébastien, il était ainsi demandé aux invités de venir fleurir des vases qui reprenaient les blessures du martyr telles qu’on les a représentées dans la peinture classique.
Ces rituels artistiques, loin d’être gratuits, soudent une communauté queer autour de symboles. Benny Nemer, qui a envisagé dans son travail les espaces de cruising et des bibliothèques comme lieux de mémoire intimes des LGBTQ+, a de plus en plus investi l’espace domestique ou cherché à le transposer dans les espaces d’exposition. Il s’agit de repeindre un mur, d’asseoir les visiteurs et visiteuses comme de leur proposer d’entrer en correspondance. L’artiste déplie des récits au travers de gestes, de protocoles comme autant d’adresses personnelles.
Pour marquer l’entrée de son appartement, il a accroché une rose au-dessus de l'œilleton. Cette simple attention, pour celles et ceux qui le connaissent un peu, ne trompe pas. La délicatesse et la prévenance de l’hôte repoussent les murs et l’on a bien du mal à juger de l’espace réel de son appartement. Les lumières bougent, les meubles également et il est aussi bien possible de les resserrer autour d’un dîner assis que de les étendre pour recevoir une trentaine de personnes pour célébrer un anniversaire.
Seuls, à vrai dire, une baignoire dans la salle de bains et la cuisine elle-même ne bougent pas et indiquent les fonctions vitales de l’appartement. Tout est habité mais d’une manière si singulière que l’on s’en trouve presque déplacé de la façon dont on pense vivre. Il n’y a pas de gobelet en plastique ou de vaisselle jetable chez Benny et tout ce que l’on tient à la main, ou porte à la bouche, a été façonné, choisi. Les bulles dans le verre, les éclats dans l’assiette ont quelque chose de rugueux, de charmant, d’unique. Aucun détail ne tient du hasard ou plutôt rien ne tient du détail, mais non par simple souci esthétique : d'abord par une recherche presque éthique. L’art de vivre, parce qu’il nécessite aussi bien de se connaître soi-même, de développer un goût que de mettre ses principes en action, est peut-être le seul art total.
Lieu de vie, de travail, de réception, ton appartement est très polyvalent et surtout modulable. Le lit est canapé et la table à manger également table de travail. C’est bien sûr une question d’espace et de dimension, mais aussi peut-être de mode de vie, une façon de marquer chaque usage par un geste de préparation. Tu changes le plafonnier de place, tu déplaces les meubles… Est-ce que c’est un lieu ou des habitudes qui définissent l’espace où tu te sens chez toi ?
Il m’arrive de penser que cette polyvalence est un effet des dimensions de l’espace mais j’ai le sentiment que c’est bien plutôt une façon de vivre. Mon approche artistique est pluridisciplinaire, je change constamment d’approches et de styles, de tonalités et de matériaux. Alors l’arrangement, que ce soient des fleurs, des cartes postales ou des céramiques, est un procédé central dans mon travail. Il semble dès lors naturel de changer l’angle de la table pour faire l’amour ; de s’asseoir et travailler dans différentes parties de l’appartement en fonction de la qualité de la lumière ; d’aller chercher un vase différent pour contenir les fleurs de la semaine. En ce sens, arranger devient aussi un mode de vie.
Quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives dans un espace, qui te fait te sentir chez toi ?
C’est dur de répondre à cette question parce que je dois admettre que ma sensibilité aux environnements m’amène fréquemment à changer différents éléments. Je suis en particulier intolérant à un mauvais éclairage. Cela me rend presque malade quand la lumière est trop violente… C’est souvent la première intervention que je vais avoir dans l’espace. Je me sens plutôt d’accord avec les idées de Jun’ichirō Tanizaki sur l’ombre et la lumière dans les espaces intérieurs tels qu’il les développe dans son célèbre livre de 1933 Louange de l’ombre. J’ai récemment vu un mème sur les réseaux, une vidéo d’un appartement tamisé avec une voix qui disait : « Je peux dire que tu es gay parce qu’aucun de tes plafonniers n’est allumé. Je sais quand je suis dans la maison d’une personne gay parce que j’y vois rien. » J’aime l’idée que ma sensibilité à la lumière fasse partie de ma sensibilité queer.
Tu as beaucoup déménagé dans ta vie et le peu de meubles traduit cette habitude-là de chercher à avoir le moins d’objets possible. Néanmoins leur ancienneté cherche à planter une stabilité et tout semble choisi, les matières aussi. On sent que ton installation s’est faite dans la durée. Comment t’es-tu meublé ?
Dans les chapitres adultes de ma vie, je me suis créé des chez-moi à Toronto, Montréal, Berlin, Édimbourg et Paris. J’ai aussi participé à de longues résidences artistiques, particulièrement à Stockholm, Brooklyn, Paris et Innsbruck, où j’ai bien plus vécu que je n’ai été un simple invité. Ces différents déménagements m’ont demandé à répétition de passer au crible mes possessions matérielles et de décider ce qui m’importait vraiment, ce que je voulais vraiment avoir à mes côtés dans de nouvelles expériences de vie. J’aimerais croire que j’ai appris à me passer de nombreuses choses et que j’ai maintenant un nombre restreint de possessions, mais j’aime les objets. Je leur attache du sens, une mémoire et des émotions. Le résultat est un ensemble soigneusement réuni d’objets, de meubles, de vêtements, de livres, d’œuvres d’art et de souvenirs de papier. Chaque objet a une histoire, souvent particulière et élaborée. Je me suis attaché à un fauteuil tapissé de velours rose dans mon atelier temporaire de Stockholm par exemple ; il m’a accompagné au travers d’une douloureuse rupture amoureuse. Trois amis suédois l’ont enregistré avec eux comme bagage lors de leur vol pour venir me rendre visite à Édimbourg ; nous l’avons transporté en bus depuis l’aéroport jusqu’à mon appartement. En aucune façon je ne pourrais me séparer d’un meuble avec une telle histoire, tellement en prise avec ma biographie relationnelle. Plusieurs objets appartenaient également à ma grand-mère, Rosalie Namer, qui a collectionné du mobilier paysan québécois du XIXe siècle. Tout cela est fait en pin et un bout des forêts canadiennes m’accompagne ainsi à Paris.
Je ne crois pas avoir vu de plastique et le métal n’est jamais poli ou étincelant. Il y a par les matériaux et les teintes une recherche de douceur et finalement chaque objet semble manufacturé plutôt qu’usiné. Même tes verres laissent voir des bulles qui signalent un verre recyclé ou soufflé à la main. À quel point cette recherche est-elle consciente ?
Ça me semble aussi relever de l’influence de ma grand-mère qui accordait une grande importance aux savoir-faire et compétences des artisans. Son esthétique en tant que potière était très influencée par la céramique japonaise qui l’a amenée, parmi d’autres choses, à développer une sensibilité wabi-sabi qu’elle m’a transmise. Ainsi des chandeliers en bronze non lustrés, des pièces sous-éclairées, des ensembles asymétriques me semblent plutôt naturels. Vivre avec la poterie de ma grand mère m’a aussi sensibilisé au pouvoir et à la beauté de voir et même de ressentir la trace du geste de l’artisan. Je suis toujours attiré par les objets qui portent une telle empreinte physique.
Au Japon, il existe un mot pour désigner les objets qui, passé cent ans, acquièrent une âme. On sent jusque dans tes instruments de cuisine que tu es attaché aux objets anciens et que cela va au-delà d’une esthétique… Tu parles du wabi-sabi : dirais-tu que c’est une philosophie de vie ?
Je me demande s’il faut vraiment cent ans pour qu’un objet acquière une âme. Je pense aux idées de Jane Bennett sur la vitalité de la matière, qu’elle étend à tous les objets : anciens et nouveaux, naturels et synthétiques, reconnaissant le « pouvoir de la chose » incarné par tout, d’un vase antique à une fourchette en plastique cassée. Bennett critique clairement la culture de la création d’objets à usage unique et jetables, comme un déni de la vitalité de la matière. Mais j’ai l’impression que, dans sa vision du monde, même la camelote produite en masse a de la vitalité. J’ai un penchant pour les vieilles choses, les choses usagées, les choses qui ont une histoire, y compris des histoires inconnues ou opaques pour moi. J’achète beaucoup de vêtements d’occasion et je préfère aller chercher des ustensiles de cuisine dans une brocante plutôt qu’au BHV. Mais j’ai l’impression d’être plus attiré par le caractère unique d’un objet que par son ancienneté ; un objet doit avoir quelque chose de spécial et la possibilité d’entrer en dialogue avec d’autres objets dans ma maison. Cela semble plus important que l’âge de l’objet, bien que les objets d’époques différentes possèdent souvent des caractéristiques inhabituelles qui m’attirent plus immédiatement. Cela peut inclure des qualités wabi-sabi, mais pas exclusivement. Je me sens toutefois totalement transporté lorsque j’entre dans un espace régi par les principes du wabi-sabi, comme chez « Le sentiment des choses », une galerie du Marais que j’adore.
Les céramiques tiennent une grande importance dans ta vie comme dans ton travail et j’aimerais que l’on aborde à présent celles de ta grand-mère. Tu les utilises au quotidien mais tu les collectes aussi et en fais l’objet d’un travail : un musée vivant, des performances pour perpétuer le souvenir. Peux-tu revenir sur cet héritage au présent ?
Je suis le petit-fils de la potière montréalaise Rosalie Namer (1925-2006), dont l’influence sur ma vie ne saurait être sous-estimée. Parmi d’autres choses, cette parenté artistique m’a permis de développer une sensibilité esthétique précoce, une pratique de l’écriture épistolaire et une sympathie pour les fleurs. À sa mort, j’ai hérité de quelque 300 pièces qui remplissent aujourd’hui ma cuisine et guident l’orientation stylistique de toute ma maison. Rosalie fabriquait exclusivement des poteries destinées à un usage quotidien. Elle produisait peu de pièces purement décoratives, de sorte que ses pots font partie – et ont toujours fait partie – de mon expérience esthétique et haptique quotidienne. Au départ, ma pratique artistique à l’âge adulte présentait peu de similitudes avec celle de Rosalie : j’ai commencé par réaliser des vidéos et des performances, créant principalement des œuvres conceptuelles. Mais il y a quelques années, ma pratique s’est élargie à des gestes plus matériels impliquant des fleurs, des lettres et des vases, me rapprochant ainsi de son univers artistique. J’ai commencé à créer des natures mortes en utilisant ses poteries et des œuvres qui activent notre correspondance par cartes postales des années 1990. Plus récemment, j’ai entrepris un projet intitulé « Musée Rosalie Namer » avec mon collaborateur et ami August Klintberg. Ce projet active l’héritage de Rosalie à travers une série de gestes artistiques impliquant des danseurs, des historiens de l’art et des fleuristes. Nous avons récemment produit une installation vidéo dans laquelle, avec le danseur Stephen Thompson, 60 pièces de poterie de Rosalie sont manipulées, arrangées et réarrangées.
Dans ton travail, les vases et les bibliothèques sont mis en scène, convoqués comme des réceptacles autour desquels on peut se réunir. Qu’en-est-il chez toi ?
Mes études doctorales portaient sur les bibliothèques, les espaces domestiques et les jardins de quatre hommes érudits âgés et homos qui m’ont permis de passer de longues périodes dans leurs maisons d’Amsterdam, de Londres et de Montréal. Ces séjours de recherche ont entraîné des changements significatifs dans mes orientations artistiques et dans ma façon d’habiter l’espace domestique, en aiguisant mon intérêt pour la façon dont les livres, les archives épistolaires, la botanique et d’autres objets coexistent dans une maison. Ces préoccupations sont aujourd’hui au cœur de ma pratique artistique. Il est vrai que presque tout ce que j’expose a un rapport avec la sphère intime de la maison, en particulier la manière dont je travaille avec les arrangements floraux et les cartes postales, comme des glissements stylisés d’actes quotidiens d’envoi de lettres et d’offrandes de fleurs dans l’espace d’exposition. Je préfère garder une échelle intime plutôt que de créer des installations botaniques monumentales ou de grandes œuvres textuelles. J’ai tendance à préférer les vidéos sur écran plutôt que les projections, et le son au travers d’écouteurs plutôt que par des haut-parleurs.
Ta bibliothèque est en elle-même un objet esthétique, on retrouve les livres en fonction de leur couleur ; c’est-à-dire que, lorsque tu recherches un livre lu, tu te rappelles l’objet de ta lecture ? Comment es-tu arrivé à ce classement ?
Organiser mes livres par couleur est un projet purement esthétique. Je n’ai jamais aimé le chaos visuel produit par le classement alphabétique des livres. Bien sûr, ce système est plus pratique, mais il semble ignorer les propriétés esthétiques et matérielles du livre. J’ai toujours classé les livres par couleur, bien que cette approche se soit révélée particulièrement importante pour favoriser un sentiment d’harmonie visuelle dans l’espace limité de cet appartement. Mes livres sont conservés dans une pièce qui sert également d’armoire, de salon, d’espace de travail, de salle à manger et de chambre à coucher. Il est donc important que l’ambiance générale de cette pièce reste calme, dégagée et équilibrée. Des blocs de couleur uniforme permettent d’y parvenir. J’ai cru un jour que je connaissais la couleur de chacun de mes livres et qu’il n’était donc pas difficile de les trouver par couleur, mais avec le temps, cette théorie s’est avérée téméraire ; il me faut souvent beaucoup de temps pour trouver un livre, surtout ceux dont la couverture se situe entre le blanc, le blanc cassé, le crème et le beige. Il m’est arrivé plus d’une fois d’abandonner ma recherche !
En parlant de couleur, les murs de ton appartement se déclinent à partir d’ocre et de sanguine, il y a une chaleur qui vient de cet arrangement et ne cherche pas à faire paraître ton appartement plus grand. Comment es-tu arrivée à ces teintes ?
J’ai un penchant fort pour certains gris pâles et chauds. Cette fascination s’exprime non seulement dans ma maison, mais aussi dans mes œuvres d’art. Je demande souvent aux galeries de peindre les murs en gris ou greige pour mes expositions. J’ai apporté cette sensibilité avec moi dans cet appartement, voulant le modeler sur les intérieurs danois mélancoliques des peintures de Vilhelm Hammershøi, et j’ai donc peint les murs et deux armoires dans le même gris. Mais peu de temps après avoir emménagé, je suis tombé sur une sanguine de l’artiste Cyril Duret, représentant un personnage debout au milieu d’arbres et de buissons, son corps se fondant dans la végétation grâce à des hachures adroites et méticuleuses. J’ai acheté ce dessin lors d’un rare coup de foudre et je l’ai accroché dans l’univers de cendres de ma pièce principale grise. Le rouge de la sanguine de Duret a commencé à pulser dans l’espace, envoyant son signal chaud d’une manière douce mais quelque peu exigeante. Il était si puissant qu’il a provoqué un changement de décor vers le rouge : j’ai ajouté d’autres détails rouges dans la pièce : une amphore sang de bœuf et des bougies rouge foncé, j’ai fini par faire retapisser le canapé gris dans un velours sanguin, j’ai acheté des stores rougeâtres pour les fenêtres, du linge de lit et des oreillers de couleur rouille. J’ai accroché au mur une affiche d’exposition de Cy Twombly griffonnée de lettres rouges. Le rouge domine également dans la cuisine, où il émane du carrelage en terre cuite.
Tu as beaucoup de vases que tu utilises en fonction des fleurs, des compositions. Comment fleuris-tu ton appartement ? En fonction de l’humeur et de la saisonnalité ? Dans ta façon ritualisée d’habiter, on sent une influence du Japon…
Il serait difficile de résumer ma relation personnelle avec les fleurs et la façon dont je vis avec elles, car il s’agit d’une grande histoire d’amour à multiples facettes qui a commencé dès l’enfance. Ma vie domestique avec les fleurs est guidée par des impulsions à la fois esthétiques et affectives et, depuis que je vis à Paris, par les amitiés que j’ai nouées avec quelques-uns de mes fleuristes préférés. Parfois, je me contente d’acheter des fleurs dans une boutique du quartier, mais souvent, je préfère entrer en conversation avec un fleuriste, composer quelque chose ensemble par le biais de la conversation. J’aime transporter le bouquet final à travers la ville. Ma collection de vases − qui a commencé avec huit vases provenant de la collection de poteries que j’ai héritée de ma grand-mère − est assez vaste et diversifiée. J’ai maintenant environ 85 vases en verre, en marbre, en laiton, en bois et en céramique : des cadeaux et des trouvailles dans les marchés aux puces, des antiquités et quelques pièces précieuses fabriquées par des ami-e-s céramistes de France, de Belgique et de Suède. Et bien que cette collection permette toutes sortes de possibilités florales, il y a encore des moments où je reçois des fleurs et où je ne trouve pas le bon vase pour les contenir. Mais j’ai appris à aimer les vases même sans fleurs. J’aime et je suis fasciné par ce type particulier de récipient, son histoire et ses significations culturelles. J’aime qu’un vase vide puisse suggérer des fleurs sans en contenir. Mes activités artistiques et intellectuelles s’orientent de plus en plus vers les vases, et j’ai eu la chance de produire quelques séries de vases en collaboration avec des potiers pour certaines œuvres d’art récentes.
Il est important dans ton travail, qui est finalement très relationnel, de recevoir. Tu tiens régulièrement salon : qu’entends-tu par là et quel regard portes-tu sur cette pratique très ancienne que tu renouvelles ?
J’ai commencé à animer des salons pendant mes études de doctorat à Édimbourg. Je me sentais très seul dans cette ville et j’avais du mal à créer la communauté dont j’avais besoin. J’ai donc essayé de générer la culture sociale et relationnelle dont j’avais besoin en organisant des salons et en invitant littéralement toutes les personnes que je connaissais chez moi. J’ai demandé à mes ami-e-s et collègues d’accomplir des gestes miniatures tout au long de la soirée − un fleuriste a arrangé un bouquet, un écrivain a lu un poème, une drag-queen a appliqué du rouge à lèvres à chaque invité − comme une sorte de programme culturel, distinguant cet événement comme un salon plutôt que comme une simple fête à la maison. Il est intéressant de noter que de nombreux invités d’Édimbourg m’ont dit que mes salons comblaient un vide dans leur propre vie sociale, et la plupart d’entre eux sont devenus des participants assidus à ces salons. J’ai appelé l’événement « Salon Rose », ce qui me paraissait ambitieux et gentiment queer. J’ai emménagé dans mon appartement parisien de la rue du Pôle-Nord en 2021, peu après que la pandémie et une rupture amoureuse ont réorganisé de façon spectaculaire mon réseau dans cette ville. J’ai ressenti une frustration similaire à l’égard de ma vie sociale, un besoin de connexion et de communauté auquel je ne parvenais pas à accéder. J’ai donc relancé mes salons, cette fois sous le nom de « Salons du Pôle Nord », afin d’encourager la culture sociale dont je souhaitais faire partie. En raison de la taille de mon appartement, la liste des invités était un peu plus limitée, plus restreinte, jamais plus de 25 personnes à la fois. J’ai modifié le programme culturel de ces salons pour qu’il soit plus collectif et participatif : j’ai demandé à chaque invité d’apporter une seule fleur, par exemple, pour contribuer à un grand bouquet collectif ou pour l’apposer dans un herbier. Les salons sont devenus des espaces joyeux de rencontres, d’échanges et de plaisir floral. Je suis ravi de t’avoir invité à l’un de ces salons, il y a maintenant presque deux ans. C’est d’ailleurs à ce salon que nous nous sommes rencontrés en personne pour la première fois…